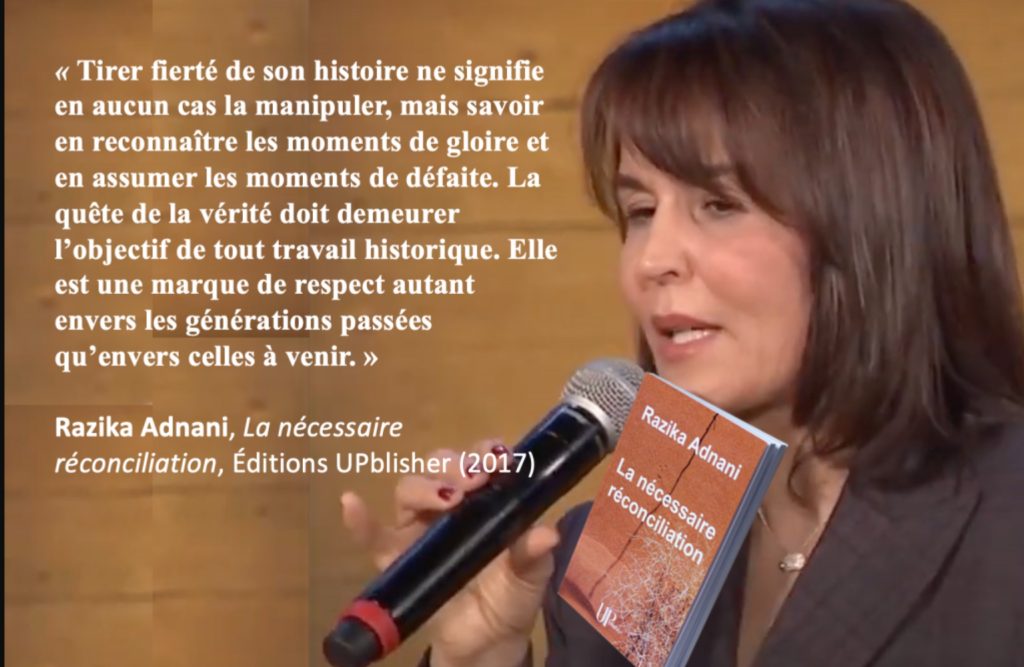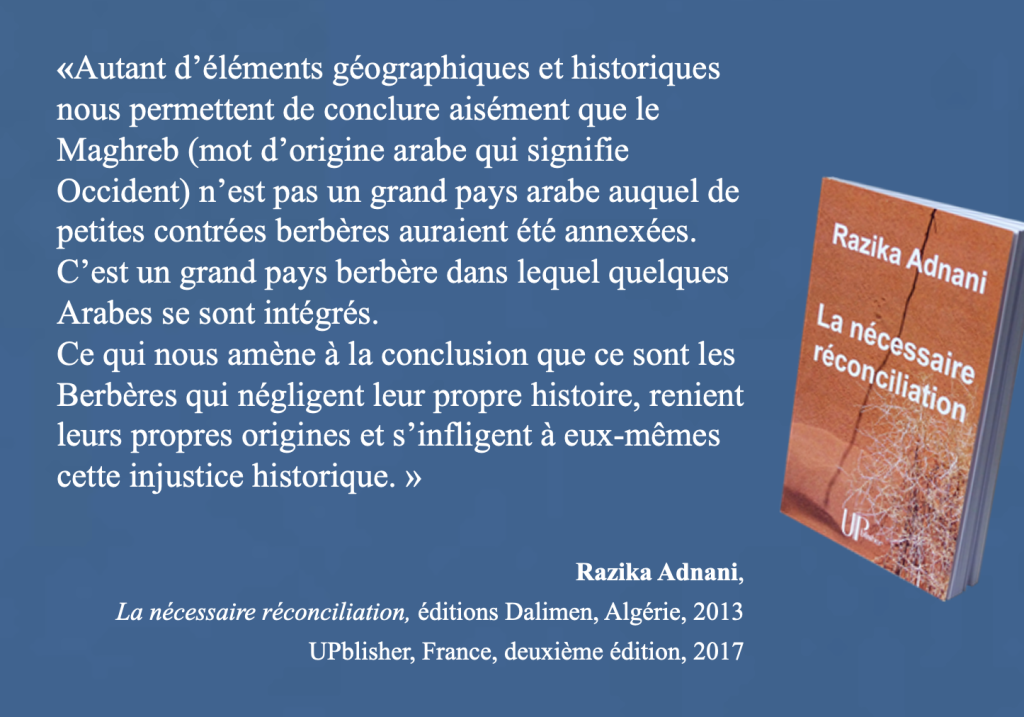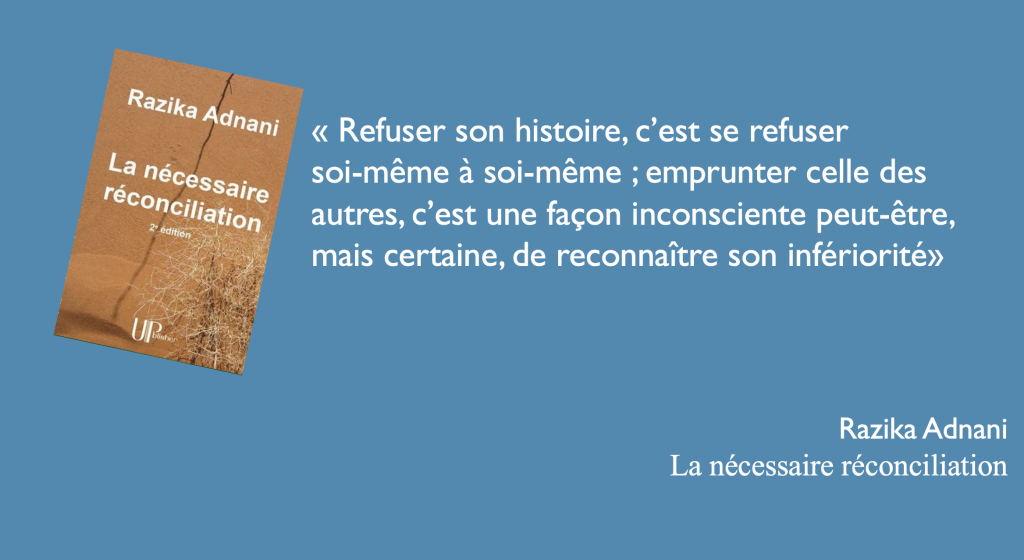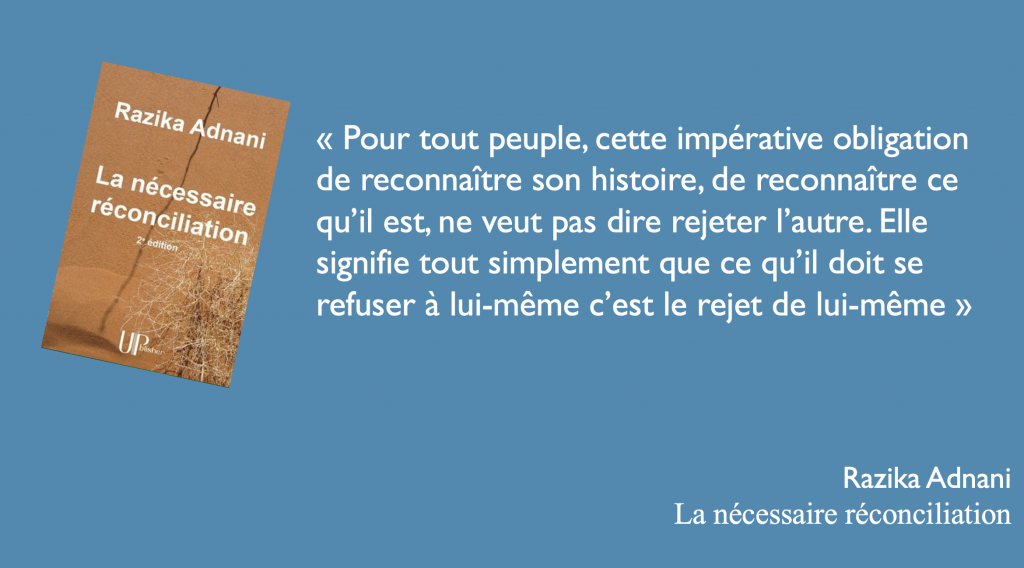« L’islamisme radical dans les sociétés berbères hier et aujourd’hui » de Razika Adnani est particulièrement riche ( Mohand Kacioui)

Compte rendu de la conférence de Razika Adnani par Mohand Kacioui
L’intervention de Mme Razika Adnani lors du colloque, qu’elle a intitulée L’islamisme radical dans les sociétés berbères hier et aujourd’hui, est particulièrement riche et s’inscrit dans une perspective historique, théologique, et sociologique. Son analyse aborde les racines de l’islamisme radical dans les sociétés berbères, en reliant des éléments du passé aux enjeux contemporains.
1. L’histoire pour comprendre le présent
Mme Razika Adnani commence son intervention en soulignant l’importance de l’histoire pour comprendre les dynamiques actuelles de l’islamisme radical dans les sociétés amazighs (berbères). Selon elle, il est indispensable de remonter aux origines des sociétés Berbères pour saisir comment l’islamisme s’est infiltré, et comment ces sociétés ont historiquement réagi à la montée des idéologies religieuses radicales.
Elle rappelle que les sociétés berbères s’étendent sur un vaste territoire allant des Îles Canaries à l’ouest jusqu’à Siwa, en Égypte, à l’est, et de la mer méditerranéenne au nord jusqu’au nord du Mali et du Niger au sud. Cette diversité géographique inclut à la fois des populations berbérophones et des populations arabophones. En ce sens, elle précise que dans son discours, elle ne fait pas de distinction entre les Berbères qui parlent le tamazigh et ceux qui parle l’ arabe, car beaucoup de Berbères se sont arabisés tout au long de l’histoire.
2. La nature politique de l’islam
Mme Adnani rappelle que le terme “islamisme” est un concept occidental, créé au XVIIIe siècle en France pour désigner la religion musulmane. Les universitaires français ont décidé de lui changer de sens au XXe siècle pour désigner l’islam politique. Un concept auquel ils ont ajouté deux qualificatifs.Pour eux, il s’agit d’un phénomène contemporain et qui n’a aucun lien avec l’islam.
Avec une telle définition, l’islamisme est un concept qui n’a aucun fondement ni historique ni théologique. Il n’avait pas d’équivalent dans la langue arabe jusqu’aux années 1980 où les linguistes ont essayé de lui créer un équivalent.
Contrairement à la position dominante, en France notamment, selon laquelle l’islamisme est distinct de l’islam, Mme Adnani insiste sur le fait que l’islam a toujours été politique depuis l’an 622, lorsque le prophète Muhammad est parti vivre à Médine où l’islam est devenu une religion indissociable du pouvoir politique. Elle souligne que même si historiquement, certains mouvements musulmans ont essayé de séparer l’islam de la politique, comme ce fut le cas des soufis qui, au VIIIe siècle, ont revendiqué un islam uniquement spirituel, c’est l’islam des juristes qui a fini par s’imposer et les soufis eux-mêmes ont fini par reconnaître l’importance de la charia comme système législatif.
3. Les Berbères face à l’extrémisme religieux : le passé et le présent
RazikaAdnani met en lumière que les Berbères n’ont pas été épargnés par les mouvements d’islam radical dans l’histoire. Elle mentionne des dynasties comme les Almoravides et les Almoahides qui ont, à leur époque, imposé un islam rigoriste dans les territoires berbères, ressemblant à certains égards aux pratiques extrémistes des groupes djihadistes actuels, tels que Daesh ou les talibans.
Elle rappelle que les Almoahides, sous la direction d’Ibn Toumert, ont imposé un islam puritain et extrémiste en interdisant notamment la consommation d’alcool, les études de philosophie et les métiers de danseurs et de chanteurs, et en forçant les conversions des juifs. Elle cite également les Aït Ifran, une tribu berbère, qui ont adopté l’idéologie kharijite, une doctrine théologique radicale et jihadiste dès le VIIIe siècle.
Ainsi, elle explique que l’extrémisme religieux n’est pas une nouveauté dans le monde berbère, mais qu’il a des racines profondes qui remontent à des dynasties et mouvements historiques ayant promu des versions très strictes de l’islam.
4. Les causes théologiques et politiques de l’islam radical
Pour Mme Adnani, plusieurs facteurs expliquent l’extrémisme islamique dans les sociétés berbères, notamment des causes politiques et théologiques.
Facteur politique
Historiquement, le pouvoir politique dans le monde musulman, qu’il soit sunnite ou chiite, revenait soit à la famille du prophète, soit à la tribu des Quraysh, à laquelle appartenait Muhammad. Pour les Berbères, qui voulaient éviter de céder le pouvoir aux Arabes, il a souvent été nécessaire de se convertir à des doctrines plus radicales pour légitimer leur propre pouvoir politique. Des tribus berbères ont également embrassé des mouvements politico-religieux comme le kharijisme car il prônait que tout musulman pieux pouvait accéder au pouvoir, indépendamment de ses origines.
Facteur théologique
Théologiquement, Mme Adnani souligne que le malékisme, la principale école juridique sunnite pratiquée en Afrique du Nord, est particulièrement littéraliste et ne laisse pas beaucoup de place à l’interprétation intellectuelle. Associé au théologisme ash’arite, qui prône une acceptation totale des textes sacrés sans poser de questions (le fameux “bila kayfa” : sans demander comment), cette école a contribué à l’absence de pensée critique dans les sociétés berbères, créant ainsi un terreau fertile pour l’extrémisme.
Elle critique également l’adhésion au soufisme comme étant une forme d’islam qui, bien que mystique, a souvent contribué à la passivité et au manque de réflexion critique dans les sociétés pratiquantes.
5. Le facteur psychologique : le complexe du nouveau converti
Mme Adnani introduit un concept psychologique original qu’elle appelle le “complexe du nouveau converti” pour expliquer la tendance des Berbères à adhérer à un islam rigide. Elle rappelle que les Berbères ont été convertis à l’islam qui est arrivé au pays des Berbères en 698 et l’islamisation des Berbères ne s’est faite qu’après deux siècles, selon Gabriel Camps. Les Berbères se sont toujours sentis comme de “nouveaux convertis” par rapport aux Arabes, les porteurs initiaux de l’islam. Ce complexe les a poussés à vouloir se montrer plus pieux et plus rigides dans leur pratique de l’islam
Elle cite également un sentiment d’infériorité chez certains Berbères, qui considéraient les Arabes comme étant le peuple choisi par Dieu pour recevoir la révélation. Ce complexe a renforcé la vénération pour la langue arabe et la culture arabe, au détriment des racines culturelles amazighes. Certains Berbères sont même allés jusqu’à renier leur propre identité pour se revendiquer comme Arabes, un phénomène largement ancré dans l’histoire, selon elle.
6. Les conséquences actuelles de l’islamisme radical dans les sociétés amazighs
Mme Adnani conclut en affirmant que les causes de l’extrémisme religieux parmi les Berbères sont aujourd’hui toujours présentes. Les mêmes causes politiques, théologiques et psychologiques qui ont contribué à l’extrémisme dans le passé se manifestent encore aujourd’hui, que ce soit en France ou dans les pays d’origine des Berbères en Afrique du Nord. L’observation montre que la réconciliation des populations berbères, arabophones ou berbérophones, avec leur histoire et leurs origines est un élément important qui les éloigne de l’extrémisme islamique. Autrement dit plus les individus sont pris par le complexe des origines et veulent être arabes, plus ils se radicalisent.
Elle met en garde contre les dangers de l’islamisme radical, qui continue de proliférer dans les communautés amazighs, en particulier parmi les jeunes, à cause de ce même sentiment de vide identitaire et de la marginalisation de la culture berbère.
Conclusion
L’intervention de Mme Razika Adnani est à la fois un rappel historique et une mise en garde pour l’avenir. Elle montre que l’extrémisme religieux dans les sociétés berbères a des racines profondes, nourries par des facteurs politiques, théologiques et psychologiques complexes. Sa solution : reconnaître et valoriser l’identité berbère, tout en combattant les interprétations rigides de la religion qui ne laissent aucune place à la pensée critique. Razika Adnani a abordé la relation complexe des berbères avec leurs origines et leur histoire dans son ouvrage La nécessaire réconciliation.